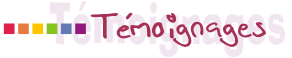ROUMANIE - Liceul Teoretic “Nichita Stanescu”, Ploiesti - Maria RADU
Comment et pourquoi alfonic ?
C'est surtout la curiosité, l'envie de voir ce que cela pouvait donner avec nos élèves, qui nous a poussés à expérimenter l'outil alfonic dans l'enseignement du français au sein d'une institution roumaine. Au départ, cet outil semblait peu utilisable chez nous. Conçu pour enseigner le français langue maternelle à de jeunes enfants, l'alfonic ne pouvait pas concerner le roumain qui, ayant un alphabet phonétique, n'avait pas besoin d'en envisager un autre. Pourtant, dans notre activité d'enseignants de français, langue étrangère, l'alfonic avait l'air de pouvoir nous aider. Les jeux multimédias, introduits par le projet, représentent un atout important qui change l'attitude de l'élève. Il se sent valorisé, dans une situation d'enseignement digne de son attention et de son effort. Nos élèves, entre 14 et 18 ans, arrivaient dans la première classe du lycée, en situation de faux débutants pour la plupart. Nous avons opté dès le début pour une sélection de sons à observer. Nous nous sommes orientés vers des sons français qui n'ont pas de correspondant dans la langue roumaine. Ce sont, en réalité, les sources les plus fréquentes d'erreur de prononciation ou d'orthographe pour nos élèves. C'était l'aspect pour lequel l'alfonic devenait intéressant pour nous. UN seul signe transposant un son [eau - au - o] signifiait simplifier la compréhension. Les apprenants étaient plus conscients de l'opposition entre les sons.
Personnellement, j'ai d'abord présenté l'alfonic à des classes terminales car elles avaient un niveau de français assez bon, mais les difficultés de prononciation persistaient. Nous avons d'abord observé les sons dans les textes du programme. Ensuite nous avons travaillé en dehors de nos cours. Ces élèves étaient elles-mêmes intéressées à améliorer leur français car elles voulaient faire des études de français après leur bac. Améliorer la lecture signifiait implicitement accomplir un travail sur l'orthographe. Ces élèves ont beaucoup apprécié le fait de faire les jeux multimédias de « Je parle donc j'écris » qui étaient en ligne à ce moment-là. Avant, elles ne se servaient pas beaucoup de l'ordinateur. L'expérience a réussi et a été appréciée. Les corrections de prononciation et d'écriture ont eu du succès. Les élèves ont découvert que l'alfonic semblait idéal pour prendre des notes. J'ai pensé aussi que, dans la perspective de leurs études de lettres, ces élèves pourraient elles-mêmes réfléchir à l'utilisation de l'alfonic dans la didactique du français, langue étrangère. Pendant cette année scolaire, nous avons commencé la correction de l'expression orale et de l'expression écrite avec les derniers arrivés dans notre lycée, en nous attachant aux sons spécifiques du français. Les jeux multimédias sur le site du projet, très nombreux, ont permis aux élèves de corriger leurs erreurs. Peu à peu ils se corrigent eux-mêmes et ils écrivent mieux.
Une constatation à laquelle je n'avais pas pensé a été le fait que la seule utilisation de l'ordinateur attire une tranche d'élèves sur lesquels je n'osais compter. Il s'agit des élèves des classes scientifiques. Très branchés sur l'informatique et sur l'anglais, ils ont été très attirés par les jeux multimédias. Ils faisaient les exercices tout en ayant l'air de jouer.
Scénario fréquent :
- on propose le repérage d'un son dans le texte;
- on passe à l'ordinateur pour les jeux sur le son en question;
- retour au texte;
- exercices d'opposition entre sons distinctifs si la situation l'exige;
- transcription de mots nouveaux en alfonic et en orthographe.
Pour vérifier si le progrès est réel ou s'il s'agit seulement d'une illusion de professeur impliqué dans le projet "Je parle donc j'écris", un test de dictée a été proposé en trois étapes : au début, au milieu et vers la fin de l'année. En moyenne la réduction des fautes est de 40 à 18. Tenant compte du temps de travail très limité, du fait que c'était une activité supplémentaire, le résultat mérite attention. Un rythme plus soutenu pourrait améliorer les résultats mais c'est un acquis.
Je ne crois pas me tromper quand j'affirme que la participation à ce projet européen nous a permis de découvrir une nouvelle piste dans la didactique du français langue étrangère. Une piste ouverte à une réflexion commune, à un échange d'observations, de points de vue. Où mènera-t-elle, cette piste? Certainement beaucoup plus loin que nous ne le pensons à présent. Tous ces échanges de spécificités dans la didactique du F.L.E., selon la langue maternelle (italien, grec, roumain, polonais, et autres) conduiront vers des conclusions intéressantes, où les nouvelles technologies pourront jouer un rôle important.
Maria RADU
18 mai 2005