![]()

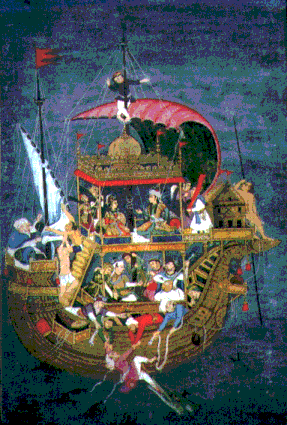
Réalisation du Petit Séminaire de Saint-Roch
Caroline WOLF - Emmanuelle VANBRABANT - Année académique 1999 - 2000
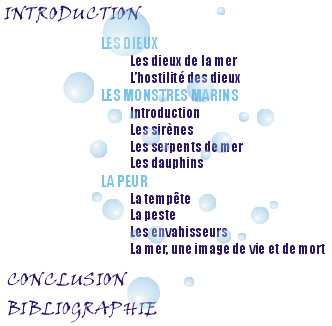
INTRODUCTION
Entre un ciel espéré, souhaité
et prié avec ferveur, et une terre sépulcrale, noire, humide, crainte
et redoutée, la mer s'impose comme le seul des trois éléments naturels
qui fasse partie intégrante de la vie de l'homme. Car l'homme n'a jamais
renoncé à ses droits d'enfant de la mer.
La mer a ses rites et coutumes, ses cérémonies particulières telle l'immersion
de ceux qui meurent à la mer victimes de la maladie et de la guerre, de
la faim ou de l'ennemi, du combat ou du temps.
Dans ce contexte fait de paysages uniques, dans ce monde si particulier
où la mort et la mer semblent deux vieilles complices, la mer mystérieuse
et féerique s'est vite imposée à l'homme comme un univers tumultueux propice
aux légendes, aux superstitions, aux incroyances et aux mythes, aux Dieux
et aux monstres, aux récits fantastiques. La mer s'est humanisée peu à
peu car les hommes, en la violant, lui ont donnée leur nom (Mer Egée,
Mer de Barents) et les marins se sont alors mis à peupler à jamais îles,
archipels et détroits (Détroit de Magellan). Marins pour lesquels la mer
généralement synonyme de peur l'a été aussi d'aventure car la mer est
liberté.
En effet, la mer est synonyme d'espace, de découvertes, d'esprit d'initiative
et de dépassement de soi. La mer est joie quand on la voit. La mer est
monde de l'impossible alors que la terre est monde du possible car quoiqu'on
y entreprenne rien n'égale la peur, l'angoisse et l'inquiétude que nous
inspire la mer.
Tout, finalement, se rattache à la mer; tout jusqu'à la mort y compris
celle du soleil qui s'éteint chaque soir à l'ouest comme en plongeant
dans l'océan et qui ressurgira le lendemain matin à l'est, symbole de
mort la veille, symbole de vie et de résurrection une douzaine d'heures
plus tard, symbole de résurrection donc symbole de Dieu. De dieu ou des
dieux.
La mer païenne a fait naître
dans l'esprit des hommes nombre de dieux à apaiser ou à solliciter, nombre
de déesses et de nymphes, de tritons et autres divinités toujours en quête
d'offrandes et de sacrifices, au point d'aller jusqu'à imposer aux marins
une véritable cohorte d'habitants mythologiques et sacrés, divins et surnaturels,
les uns monstrueux, les autres bienfaisants, mais tous étonnants, à la
morphologie étrange, empruntée à la fois aux mondes humain et animal.
Les poètes grecs considéraient l'océan comme un être divin (Okeanos) père
de tous les fleuves. Poséïdon (le briseur de navires) y régnait et partageait
son royaume avec son épouse Amphitrite. Le trident représentait le symbole
de sa royauté. Dans le très ancien royaume des Dieux, Neptune était considéré
comme le Dieu de la mer, tant par les poètes que les philosophes antiques.
En fait, il personnifiait plus exactement la navigation et commandait
les flots en monarque absolu. Dieu de l'Olympe, il était un des trois
maîtres de l'univers avec ses pères, Zeus, maître du ciel, de la foudre
et du tonnerre, et Hodes, souverain du monde souterrain. Dans les profondeurs
de mer s'élève l'impressionnant palais de Poséïdon qu'il ne quitte que
dans son char de triomphe en forme de coquille tiré par des chevaux marins.
A toute allure, le dieu entouré de dauphins et de monstres marins fend
les ondes sauvages, sur son ordre se rassemblent les nuages annonciateurs
de la tempête, s'élèvent les vagues déchaînées. Il souscite les ouragans
et, des coups de son trident, fait trembler la terre et fait se fendre
les montagnes.
Pourtant, Poséïdon ne se révèle pas toujours le dieu redoutable. Il peut
aussi imposer le silence à la tempête, retenir les vagues, offrir une
heureuse navigation aux marins.
A la suite de Poséïdon, appartenaient les Tritons, moitié homme moitié
poisson. A l'origine Triton était un Dieu secondaire fils de Poseïdon
et d' Amphitrite, mais l'imagination des poètes anciens a multiplié le
nombre de Tritons.
Selon les descriptions, ils chevauchaient des montures marines ou des
dauphins et accompagnaient leur maître au cours de ses expéditions.
Les marins germaniques connaissaient au moins un Dieu de la mer auquel,
en cas de danger, ils pouvaient avoir recours. Près de Wotan siégeait
Norder, la rose des vents, qui régnait sur le feu et sur la mer. Lorsque
hurlaient des tempêtes sauvages en mer, les marins en détresse suppliaient
Norder de sauver leur bateau et leurs vies. La domination des vents appartenant
à Frahos, fils de Norder. Avant chaque expédition, les marins promettaient
argent et bière à Fraho s'il les gratifiait d'un vent favorable.
Poséïdon et son fils Eole, dieux des vents, s'inscrivent en effet dans
une série de légendes qui s'enchevêtrent les unes aux autres. Le trident
de Poséïdon et les joues gonflées d'Eole sont des symboles omniprésents.
Athena joue également un rôle actif dans le domaine de la marine : déesse
de l'intelligence et de l'ingéniosité, c'est elle qui enseigna à l'homme
l'art de construire les navires. C'est d'elle que le marin grec tient
son intelligence navigatrice et la ruse dont il a besoin pour affronter
la puissance imprévisible de la mer.
Vu leurs diversités, il serait difficile d'énumérer tous les dieux marins
car les légendes diffèrent et se multiplient à leurs propos.
Pour calmer les divinités, l'idée
de sacrifices s'est très vite imposée. Monstres et dieux étaient si étroitement
associés que le mot " requin ", à l'étymologie fort obscure, aurait pour
origine, dit-on, le mot " requiem" : prière pour les morts. Sacrifices
presque toujours beaucoup plus sanguinaires que les monstres eux-mêmes
comme en fit la tragique expérience le malheureux Jonas, tiré au sort,
jeté à la mer et avalé par une baleine.
La Mer a en effet imposé aux hommes, au cours des siècles, des sacrifices
semblables à celui que Dieu imposa à Abraham : ainsi Idoménée, roi légendaire
de Crète, prétendant d'Hélène, menacé par la tempête en rentrant du siège
de Troie, dut-il promettre à Poséïdon de sacrifier le premier être qu'il
rencontrerait en débarquant sur les rivages de l'île. Son fils vint l'accueillir
: il l'immola !
Ces sacrifices cruels poussaient les anciens à offrir régulièrement à
la mer des offrandes rituelles, en guise d'exorcisme, notamment des chevaux
ou des taureaux, symboles de fécondité. Ainsi, les peuples côtiers d'Afrique
prirent-ils la féroce habitude d'attacher leurs malheureuses victimes
sur la grève, à marrée basse, en attendant que la marée haute y ramène
les requins !
Offrandes adoucies par la suite : les marins polonais prirent l'habitude
de jeter à la mer de simples poupées de paille. Les Espagnols, quant à
eux, n'hésitaient pas à plonger dans les vagues les reliques de saints.
Moins démonstratifs, les marins portugais récitaient le prologue de l'
Evangile selon Saint Jean. Et si souvent qu'il finit par figurer au rituel
de l'exorcisme !
Au 17ème siècle, les Barbaresques embarquaient vivants de nombreux moutons
pour, en cas de tempête, les couper en deux, vivants, et jeter une moitié
à bâbord et l'autre à tribord jusqu'à ce que la mer se calme.
Très tôt, les grecs ont créé
toute une hiérarchie de personnages fantasmagoriques, au corps monstrueux,
généralement mi-humain, mi-animal : monstres à plusieurs têtes, à plusieurs
corps, pourvus de cous tentaculaires, de têtes d'hommes et de poitrines
de femmes, et qui s'achevaient en une ou deux queues, de poissons ou d'oiseaux.
La mer est toujours apparue peuplée d'une étonnante animalerie, présente
dans les légendes grecques comme dans la Bible. C'est dans un monde paranormal
que se côtoyaient animaux fantaisistes et animaux à peu près réels : monstres
du fond des eaux, serpents de mer, baleines énormes, pieuvres à six ou
sept têtes et aux tentacules immenses, ainsi que d'autres animaux gigantesques,
effrayants et dangereux, hormis les dauphins.
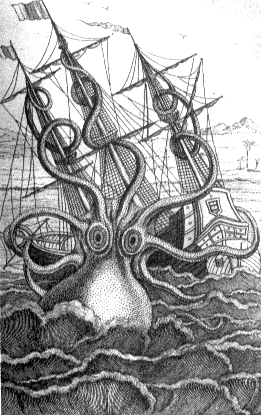
Certains de ceux-là s'élevaient
des profondeurs de la mer pour poursuivre les bateaux et s'emparer des
malheureux marins. La mer se prête à la légende car elle irrite les passions,
les déchirements, l'angoisse des mères, des épouses, des filles. Par exemple,
pour la femme du marin, la mer est la pire des rivales, une maîtresse
qui ne rendra jamais l'homme après l'étreinte (fatale ?).
Dans l'antiquité, le surnaturel se confond avec le mythe. Poseïdon, Triton
et autres dieux et déesses de la mer sont très actifs dans le monde greco-romain.
Mais découvrons d'autres personnages qui, peu à peu, sont venus habiter
mers et océans.
Présentes dans les mythologies, les sirènes occupent une place privilégiée dans notre imaginaire. Figures étranges et fatales de l'éternel féminin, elles ont quitté le monde des dieux pour s'associer à jamais au monde de la mer.
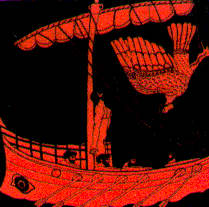
Filles de Melpomène, la muse
du chant et de la tragédie, et Achéloos (fils d'Océanos et de Téthys),
génies de la séduction, de la mort et de la musique funèbre, les sirènes
sont représentées d'abord sur les tombes égyptiennes, avec une tête et
des pieds de femme, mais avec un corps et des ailes d'oiseaux, puis, plus
tardivement, sous forme de poisson, avec une tête et une poitrine de femme
qui émergent d'une rutilante queue d'écailles. Queue de poisson qui symbolise
une sorte de serpent et qui fait d'elle un véritable démon femelle. Femme-oiseau,
la sirène symbolisait las âmes des morts au moment de leur séparation
d'avec le corps. Les sirènes tirent leur nom de grec " seirazein " qui
signifie " attacher avec une corde ". Les sirènes chantent la mer, d'une
voix captivante héritée de leur mère, accompagnées d'une lyre ou d'une
double flûte, afin de charmer les malheureux marins privés de femmes depuis
trop longtemps, de les attirer sur les écueils et de les dévorer. Néanmoins,
elles sont créatures vulnérables puisqu'un ancien oracle leur à prédit
un jour qu'elles n'existeraient que tant qu'elles réussiraient à charmer
les navigateurs, et qu'elles périraient le jour où l'un d'eux leur
résisterait.
Orphée fut le premier à leur résister grâce à la supériorité de sa lyre.
Et les sirènes se seraient suicidées après cet échec.
Symbole de passion charnelle et de désir sexuel, la sirène est en réalité
un monstre anthropophage comme nombre de monstres marins.
Selon les anciens récits, le serpent de mer serait un animal des plus dangereux qui pouvait mesurer plusieurs dizaines de mètres de long.

Il attaquait les navires pour les faire sombrer, après quoi il dévorait les matelots. Ceux-ci connaissaient une méthode fort simple pour mettre les serpents en fuite : enduire le pont du navire de musc car ces derniers ne supportaient pas cette odeur.
A l'origine, le dauphin était un homme. Dionysos s'embarqua un jour sur un navire pour se rendre à Nascos, mais des pirates s'étaient introduits dans l'équipage et dirigeaient le navire vers l'Asie. Alors Dionysos paralysa le bateau avec des guirlandes de vignes, si bien que les pirates, devenus fous, se précipitèrent dans la mer où ils devinrent des dauphins. Ceci explique que les dauphins soient les amis des hommes et s'efforcent de les sauver dans les naufrages car ce sont des pirates repentis.
Symboles de sagesse et de prudence, remarqués très tôt par les navigateurs pour leur intelligence et leur complicité, les dauphins transportent les hommes, vivants ou morts sur leur dos.
La mer a toujours engendré de grandes peurs. Les Latins disaient prudemment : " Louez la mer, mais tenez vous sur le rivage ". Dans toute l'Europe médiévale et moderne, cette peur est profondément ancrée (Même en Hollande, patrie des gueux de la mer). Car la tempête ne cesse de menacer, du plus petit radeau jusqu'au plus puissant vaisseau de guerre de la flotte.
La mer tempétueuse suscite l'angoisse du marin et la peur du risque qu'il encourt : le naufrage.
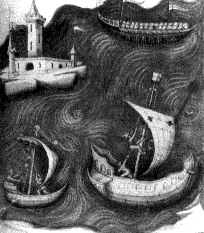
Celui-ci est omniprésent dans les chroniques médiévales. La mort guette toujours le marin mais également les terriens, lorsque la mer en furie, authentique raz-de marée, monte à l'assaut du rivage.
D'autres fléaux propagés par la navigation sont encore plus terribles que la tempête et que la foudre car ils entraînent une mortalité bien plus importante que celle liée au naufrage d'un simple navire. Ainsi, la célèbre peste noire de 1348 emporta un bon tiers de l'Europe. Elle conserva jusqu'au XVIIIème siècle un caractère mystérieux et imprévisible. Synonyme de " contagion ", de " grande mortalité " et symbole de mort (les trois quarts des pestiférés en meurent), elle ravagea la France. Face au danger venant de la mer, les autorités municipales locales se mobilisèrent, entre le XVIème et le XVIIIème siècle, avec de plus en plus d'efficacité. Elles tentèrent régulièrement d'enrayer le fléau en prenant plusieurs mesures : établissement de cordons sanitaires, nécessité, pour les capitaines, de présenter des " certificats de santé ", attestant qu'ils n'avaient point de malades à bord; " billets de transport " prouvant que les marchandises à débarquer ne venaient point d'un port contaminé; enfin, tout navire ne devait débarquer hommes et marchandises que quarante jours après son appareillage.
La mer signifie souvent envahisseur.
D'où la volonté des hommes de se protéger du côté de la mer grâce à toute
une panoplie de moyens de défense : ports nouveaux, enceintes fortifiées,
tours littorales et crénelées, estacades de bois, de pieux et de chaînes
montés sur de vieux vaisseaux pourris et coulés une fois remplis de pierres.
En cas de danger venu de la mer, l'homme met tout en oeuvre pour se protéger
de l'attaque ennemie, quitte à saborder sa propre flotte pour empêcher
l'assaillant d'entrer. Ce que fit la marine à Toulon en 1707, et toujours
à Toulon pour faire face aux Allemands lors de la seconde guerre mondiale.
d. La mer, une image de vie et de mort
La mort ne s'oppose pas à la
vie, dont elle serait la négation, mais à la naissance, et elle se présente
par conséquent dans la plupart des religions comme une " re " naissance,
ou un passage obligé vers la résurrection. Dans la plupart des civilisations,
l'eau constitue l'élément premier. Celui qui existait avant la création.
Tout va à la mort, tout vient de la mer. Dans toutes les religions, la
Mer - dont le symbolisme général rejoint celui de l'eau purificatrice
- est omniprésente; même si, suivant les différentes religions, la mer
se confond avec les principes fondamentaux (l'intelligence, la beauté,
la vie). La mer de la nuit et l'image de la barque se trouvent omniprésentes
dans toutes les légendes funèbres, que ce soit chez les Grecs, les Egyptiens
ou chez les Mésopotamiens, on confiait les défunts à une barque, lâchée
sur un fleuve qui allait gagner la mer, ou directement sur la mer elle-même.
Ceci arrivait également avec des bébés abandonnés, le plus célèbre exemple
étant certainement Moïse, qui fut abandonné à la naissance au Nil.
![]()
" … ô Mer, tu es si puissante, que les hommes l'ont appris à leurs propres dépens. Ils ont beau employer toutes les ressources de leur génie… incapables de te dominer. Ils ont trouvé leur maître. Je dis qu'ils ont trouvé quelque chose de plus fort qu'eux. (…) La peur que tu leur inspires est telle qu'ils te respectent. Malgré cela, tu fais valser leurs plus lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. (…) C'est pourquoi, je te donnerais tout mon amour (et nul ne sait la quantité d'amour que contiennent mes aspirations vers le beau), si tu ne me faisais douloureusement penser à mes semblables, qui forment avec toi le plus ironique contraste, l'antithèse la plus bouffonne que l'on ait jamais vue dans la création.(…). "
Lautréamont, Les Chants de Maldoror
![]()
ROUX Michel, L'imaginaire
marin des français, L'Harmaton 1997
SEBILOT Paul, La mer, Imago 1983
Van HAGELAND, La mer magique, Marabout 1973
VERGE Michel, La mer, Lebaud 1997
